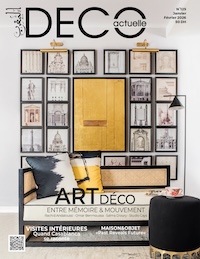Professeur Omar Sefrioui, médecin spécialiste en gynéco-obstétrique
Quels sont les facteurs de risque du placenta prævia et du décollement placentaire, et comment les détecter précocement pour prévenir les complications materno-fœtales ?
Les principaux facteurs de risque du placenta prævia sont les gestes endocavitaires, notamment les aspirations et les curetages. De même, les cures de synéchies utérines, définies comme des accolements à l’intérieur de l’utérus, ainsi que les antécédents de césarienne constituent des éléments favorisant son apparition.
Le placenta prævia correspond à une insertion basse du placenta au niveau du segment inférieur de l’utérus. Sa particularité réside dans le fait qu’il s’implante dans une zone dépourvue de muscle, donc sans myomètre. Or, le myomètre joue un rôle essentiel dans la contractilité utérine et dans le phénomène des « ligatures vivantes ». En temps normal, lors de l’extraction du bébé, le placenta doit se détacher et les vaisseaux reliant la mère et l’enfant se referment naturellement grâce aux contractions utérines. Dans le cas du placenta prævia, la contraction de l’utérus est insuffisante à ce niveau, ce qui augmente le risque d’hémorragie. Dans certaines situations, le placenta peut s’insérer plus profondément, jusqu’à envahir la paroi utérine, voire atteindre la vessie. On parle alors de placenta percreta.
Quelles sont les stratégies de prévention de l’insuffisance cervicale après une fausse couche tardive, et quand faut-il envisager un cerclage ?
La béance cervico-isthmique correspond à une incompétence du verrou isthmique du col, situé entre le col et la cavité utérine. Son rôle est d’assurer la fermeture de l’utérus pendant la grossesse afin de prévenir les fausses couches tardives et les accouchements prématurés. Lorsque ce verrou est défaillant, le col s’ouvre prématurément, entraînant une expulsion du fœtus ou favorisant l’ascension de germes depuis le vagin, pouvant provoquer une chorioamniotite et la rupture prématurée de la poche des eaux. La prévention repose principalement sur la réduction des gestes pouvant dilater le col, notamment lors d’interventions médicales comme une aspiration en cas de fausse couche. Cette béance est plus fréquente chez les femmes présentant des malformations utérines, notamment les cloisons utérines ou les utérus didelphes, qui sont des utérus divisés en deux à la naissance. Dans ces situations, un cerclage prophylactique peut être recommandé dès la première grossesse, car le risque de fausse couche tardive ou d’accouchement prématuré atteint 25 à 30 %.
Le cerclage est indiqué lorsque des fausses couches tardives ou des accouchements prématurés surviennent en raison d’une béance cervico-isthmique, sans autre cause identifiée.
Deux techniques existent :
Le cerclage classique, qui consiste à placer un fil épais autour du col, au niveau de l’isthme, pour le maintenir fermé.
Le cerclage laparoscopique, une méthode plus efficace mais plus invasive, où une bandelette est placée autour de l’isthme par cœlioscopie. Ce type de cerclage est souvent définitif et impose une césarienne pour l’accouchement.
Eviter les complications
Il est primordial d’établir un diagnostic précoce, avant même l’extraction, afin de prendre toutes les précautions nécessaires. Cela inclut notamment une anticipation des besoins en transfusion sanguine, une extraction prudente et une incision utérine réalisée à distance du placenta. Dans certains cas, il est nécessaire de laisser le placenta en place et de procéder à des gestes vasculaires, comme l’embolisation, qui permet de bloquer les vaisseaux alimentant l’utérus et responsables du saignement.