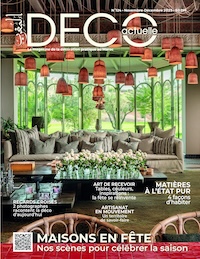En décembre dernier, le Ministre de la Justice, Abdelatif Ouahbi, a dévoilé les grandes lignes des principales avancées et modifications envisagées pour réformer la Moudawana. Des propositions, basées sur les travaux de l’instance chargée de cette réforme et l’avis du Haut Conseil des Oulemas, marquent une étape importante dans l’évolution des droits familiaux au Maroc.
Immédiatement après cette annonce, les commentaires ont fusé. D’un côté, les voix conservatrices considèrent que ces modifications vont trop loin, estimant qu’elles pourraient ébranler des principes religieux et culturels profondément ancrés. De l’autre, des partisans du changement jugent ces réformes insuffisantes pour répondre pleinement aux attentes et aux besoins des femmes marocaines. Ces derniers appellent à des mesures plus ambitieuses, notamment en matière d’égalité dans le mariage, de procédures de divorce et de droits parentaux.
Malgré les voix discordantes de ses détracteurs et de ses défenseurs, le projet de réformes suit son cours. Mi-janvier, une commission interministérielle spéciale a été formée pour finaliser le texte de la nouvelle Moudawana, l’étape définitive avant sa présentation au Parlement.
Dans l’attente du texte final, nous avons décidé de donner la parole à quatre intervenants pour éclairer ce débat. Deux d’entre eux, acteurs de l’intérieur, ont participé directement à l’instance chargée de la réforme de la Moudawana, tandis que les deux autres sont des figures reconnues de la société civile, engagées de longue date en faveur des droits des femmes. Leurs analyses, empreintes de leurs expériences respectives, apportent un éclairage précieux sur les enjeux et les attentes liés à ces réformes.

Mohamed Abdelouahab Rafiqui :
«Un islam éclairé au service de la réforme»
Mohamed Abdelouahab Rafiqui, ancien idéologue de la pensée salafiste, incarne aujourd’hui un islam éclairé et libéral. Conseiller auprès du ministère de la Justice, il joue un rôle clé dans les réformes de la Moudawana et du Code pénal, en prônant une relecture moderne du Coran pour répondre aux besoins de la société contemporaine.
Les changements sociaux rendent indispensable une adaptation des lois aux réalités actuelles.
Comment l’islam modéré peut-il contribuer à répondre aux besoins des familles dans une société en évolution ?
Contrairement aux interprétations traditionnelles qui freinent le progrès, l’islam modéré permet une relecture conceptuelle des textes du Coran et de la Sunna. Sans cet effort d’interprétation (ijtihad), il est impossible d’instaurer des lois modernes, adaptées aux problématiques auxquelles font face les familles d’aujourd’hui. Des résistances existent mais elles n’ont pas empêché des avancées notables, parfois via des solutions alternatives, à l’instar de la donation des filles pour régler la question de l’héritage.
Quels ont été les principaux défis auxquels l’instance chargée de la réforme de la Moudawana a été confrontée ?
Le principal enjeu était d’atteindre le bon équilibre entre la préservation des grands principes de l’islam et l’avancement des droits des femmes et des enfants. Les changements sociaux, comme le rôle croissant des femmes dans l’économie (20% des familles sont financées par des femmes selon les chiffres du HCP), rendent indispensable une adaptation des lois aux réalités actuelles.
Quels ont été les sujets les plus délicats et les plus grandes avancées ?
La commission a formulé 139 propositions, dont 20 liées à des questions religieuses qui ont été soumises au Conseil supérieur des Oulémas. Celui-ci en a approuvé 17 et rejeté 3. Voilà pour les points qui ont fait débat. L’une des principales avancées est la restriction drastique des exceptions permettant au juge d’autoriser un mariage en dessous de l’âge légal de 18 ans. L’objectif est clairement l’éradication des mariages précoces. La réforme valorise également le travail domestique des femmes et permet une gestion des biens communs selon l’accord prénuptial choisi. Ces ajustements reflètent un effort important pour équilibrer les droits des femmes.
Des réformes sur la tutelle et la garde des enfants étaient très attendues…
Les avancées sur ce sujet sont nombreuses et majeures. Désormais, la tutelle légale des mères est reconnue, leur permettant de gérer seules les démarches administratives pour leurs enfants, y compris le retrait de passeport. La garde commune peut être établie après un divorce, par accord entre les deux parents.
En cas de désaccord, la garde revient à la mère, même après son remariage, ce qui est inédit. Toutefois, si des conflits surgissent ou si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut intervenir pour transférer la garde à l’un des parents.
Quel impact aura cette réforme pour le Maroc tant au niveau national qu’international ?
Cette réforme, axée sur des mesures concrètes comme la limitation stricte des mariages des mineurs et des acquis majeurs pour les femmes marocaines traduit une volonté claire d’harmoniser les principes de l’islam avec les engagements internationaux du Maroc, notamment en termes de promotion de l’égalité des droits entre hommes et femmes, ainsi que de protection de tous les enfants, ainsi que l’a rappelé Sa Majesté le Roi dans son discours du 29 juillet 2022. Ces avancées renforcent à la fois l’image du Maroc à l’échelle mondiale et les droits des femmes au niveau national.
Fedwa Misk :
«l’égalité, un chantier auquel nous devons tous prendre part»
Fedwa Misk, médecin de formation, autrice, et militante, défend les droits des femmes au Maroc. Fondatrice de «Qandisha» (2011), elle a signé des œuvres marquantes comme «Nos mères (2021) et «Des femmes guettant l’annonce» (2024). Son regard éclaire les réformes de la moudawana.
Changer les paradigmes passe forcément par l’éducation.
Quand il a été question d’une nouvelle réforme de la Moudawana, quels sont les articles que vous espériez voir modifier en priorité ?
Il y avait tout d’abord la question de la tutelle qui me paraissait cruciale à régler. Les femmes, qui avaient systématiquement la garde de leurs enfants, étaient empêchées d’entreprendre toute forme d’actions d’ordre administratif, financier ou même éducatif, sans l’aval des ex-conjoints. Or beaucoup d’hommes utilisaient ce privilège pour régler des comptes avec les femmes, en mettant en péril l’intérêt de leurs enfants. Pour moi, c’était une priorité. J’ai écrit le scénario d’une série télévisée diffusée sur 2M en avril dernier, qui traite précisément de ce sujet. Ensuite, il y a la question de la valorisation du travail domestique et la protection des biens de la famille en cas de décès.
Quelles sont les avancées que vous saluez ? Quels sont vos plus grands regrets ?
Évidemment, je salue la décision de ne pas priver les femmes de la garde de leurs enfants quand elles prévoient de refaire leur vie avec un autre homme. On sait très bien que la majorité des femmes sacrifiaient leur vie amoureuse pour garder leurs enfants. Je salue également l’intention de valoriser le travail des femmes au sein de leurs foyers. Même si je pense que cela ne va pas être si simple de convaincre les hommes et les femmes de quantifier ce labeur, qui pour la plupart est acquis à la signature du contrat de mariage. Par contre, je regrette que le Conseil des Oulémas se soit montré conservateur sur la question de l’héritage en refusant catégoriquement d’annuler l’accès à l’héritage à des membres de la famille en l’absence d’héritier mâle. Pour moi, c’est non seulement une injustice en désaccord avec l’esprit de l’islam, mais aussi une injure à l’égalité des genres et au respect des femmes. Je regrette également le rejet du recours au test ADN pour légitimer le lien filial, alors qu’on l’utilise pour prouver une paternité à la demande du père.
Dans votre dernier ouvrage, vous traitez de l’IVG.
La réforme apporte-t-elle des avancées sur cette problématique ?
La loi de l’IVG ne dépend pas de la Moudawana, mais du Code pénal. Et comme la réforme du Code est en cours, j’ai encore grand espoir que l’IVG soit traitée comme une question de santé publique et que la décision d’interrompre ou non la grossesse soit prise entre la patiente et son médecin, quel que soit le statut social de la patiente. Je rappelle que «la santé est un état de bien-être physique, mental et social», selon l’OMS, et que le médecin est apte à comprendre les enjeux et les risques d’une grossesse non désirée sur l’avenir des femmes.
Quels sont, selon vous, les changements concrets qui pourraient garantir l’égalité des genres dans les pratiques familiales ?
En logique mathématique, il y a la condition nécessaire et la condition suffisante. Malheureusement, le changement des lois est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour instaurer l’égalité. Il ne va pas forcément ruisseler sur le noyau familial qui baigne depuis des lustres dans un système discriminatoire et qui assoit la supériorité masculine. Il y a un travail colossal à réaliser pour changer les paradigmes et cela passe forcément par l’éducation à travers tous les canaux possibles : école, médias de masse et culture. C’est un vrai chantier auquel nous devons tous prendre part.

Sanaa El Aji El Hanafi :
«le Code pénal, l’autre terrain de lutte pour les droits des femmes»
Docteure en sociologie, Sanaa El Aji El Hanafi est une voix marquante des débats sociétaux au Maroc. Autrice de «Sexualité et célibat au Maroc» (2018), journaliste et cofondatrice de Marayana.com, elle milite pour l’égalité, la tolérance et la liberté individuelle, abordant sans tabou des sujets sensibles comme la religion et la sexualité.
J’espère que nous aurons de bonnes surprises dans les moutures prochaines
Lorsqu’il a été question de réforme de la Moudawana, qu’espériez-vous voir modifier en priorité ?
J’espérais vraiment des réformes profondes concernant l’héritage (notamment le «taassib» quand il n’y a que des filles) et le testament. Mais aussi le recours à l’ADN, la tutelle juridique des mamans et le maintien de la garde aux mamans divorcées après leur remariage.
Quelles avancées saluez-vous? Et quels sont vos plus grands regrets ?
Il y a quelques avancées notables, notamment la valorisation du travail domestique. Il y a aussi le retrait du foyer conjugal de l’héritage jusqu’au décès du conjoint restant en vie. À cela s’ajoutent la tutelle juridique des mamans sur leurs enfants et le maintien de la garde des enfants même après le remariage.
Par ailleurs, il est très dommage qu’on n’ait pas avancé sur les règles de l’héritage, particulièrement le «taassib», sachant qu’un effort de «ijtihad» (effort d’interprétation dans les traditions musulmanes) aurait pu être fait. Il est tout aussi dommage qu’on ait rejeté le recours à l’ADN pour préserver les droits des enfants nés hors mariage.
Dans vos écrits, vous abordez le manque de liberté des femmes, notamment concernant la sexualité hors mariage et le respect de l’intimité. Cette réforme de la Moudawana aborde-t-elle de manière satisfaisante cette problématique ? Comment faire des avancées dans ce domaine ?
Je pense que ce sera plutôt à débattre dans le futur Code pénal. C’est là où il y a le plus de restrictions concernant la sexualité. Nous avons besoin d’abolir tous les articles du Code pénal restrictif des libertés. Ceci dit, le refus, dans l’actuelle réforme de la Moudawana, du recours à l’ADN est une injustice vis-à-vis des mamans célibataires et des enfants nés hors mariage. J’espère que nous aurons de bonnes surprises dans les moutures prochaines.
Quels changements concrets devrait-on voir pour garantir l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier sur les questions de liberté sexuelle et d’autonomie corporelle ?
Comme je le disais plus haut, les restrictions sexuelles sont plutôt du domaine du Code pénal. Donc à priori, il n’y aura pas d’impact de la Moudawana sur ce volet.
Cette réforme visait à adapter le droit de la famille aux réalités contemporaines. Selon vous, quelles sont les prochaines étapes à franchir pour assister à des changements réels et durables, notamment sur les droits sexuels des femmes ?
Nous avons tout simplement besoin de changer l’esprit des lois de manière générale pour qu’elles puissent se baser sur deux volets : d’abord l’égalité totale entre les hommes et les femmes dans les droits et obligations, et ensuite une réelle prise en considération des transitions sociales, économiques et culturelles.

Aawatif Hayar :
«Renforcer l’équilibre et la résilience des familles»
Ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille jusqu’en octobre 2024, et membre de l’Instance chargée de la révision de la Moudawana, Aawatif Hayar ne peut qu’apporter une expertise et une explication uniques sur l’évolution en cours, en plus de la vision tournée vers l’avenir d’une présidente d’université, professeure experte en politiques sociales et en intelligence et durabilité des villes et territoires.
Parler d’équilibre au sein des familles, c’est parler d’équilibre entre les deux fondateurs de la famille, l’homme et la femme.
Quels sont les points/articles que vous espériez voir modifiés en priorité ?
Depuis le discours du Trône du 30 juillet 2022 de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, nous avons créé, au niveau du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, une cellule de veille pour identifier et classer les problématiques soulevées lors des débats publics ou dans la presse. Nous avons ensuite présenté ce travail devant l’Instance chargée de la révision de la Moudawana incluant les propositions du ministère sur le sujet, et écouté avec les autres membres de l’Instance les problématiques soulevées par les acteurs de la société civile, les partis politiques et les institutions concernées lors des séances d’écoute. Ensuite l’Instance a élaboré des propositions de révision de la Moudawana, selon les orientations précisées dans la Lettre Royale envoyée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, Amir al Mouminine, au Chef du Gouvernement, qui ont défini le cadre et les références du travail de l’Instance, avant de les soumettre à Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste. Et pour vous répondre sur les priorités identifiées, tout en respectant la confidentialité des travaux de l’Instance, je dirai qu’en général, nous nous sommes surtout focalisés sur des propositions qui répondent aux problématiques réelles soulevées et surtout qui renforcent l’équilibre et la résilience des familles.
Parler d’équilibre au sein des familles, c’est parler d’équilibre entre les deux fondateurs de la famille, l’homme et la femme, sans que ce soit au détriment de l’un ou l’autre et tout en préservant l’intérêt général des enfants. Renforcer la résilience de la famille passe par la lutte contre le divorce, à travers la proposition d’institutionnaliser les procédures de réconciliation et médiation familiale, ainsi que par la protection des époux pendant et après la rupture de la relation conjugale ou après un décès, notamment à travers l’organisation de la gestion des biens familiaux pour éviter de créer des situations de familles vulnérables. Cela passe aussi par le renforcement des responsabilités de la femme pour qu’elle joue pleinement son rôle à côté de son époux au sein d’une famille équilibrée.
Il s’agit également de privilégier l’intérêt général des enfants, en luttant contre le mariage des mineurs, principalement les filles, dans notre pays. Aujourd’hui, fini les familles étendues, elles sont principalement nucléaires, ce qui signifie que les parents sont souvent isolés et font face à de multiples défis sociaux, économiques et technologiques et cela, dans un environnement en constante évolution. Gérer une famille est une responsabilité de plus en plus complexe et cruciale dans le contexte de la mondialisation et de l’utilisation de plus en plus grande de l’intelligence artificielle dans le quotidien des familles. Il est par conséquent primordial que les jeunes «filles et garçons» y soient préparés.
Notre pays, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à asseoir les fondements et renforcer les piliers d’un État Social, a réalisé de grands progrès, notamment la généralisation de l’accès à l’éducation. À présent, une école existe dans chaque village et le transport scolaire et les Dar Talib et Taliba sont réparties partout dans le monde rural. Pourtant des milliers de filles se voient privées de continuer leurs études. Un accès égal à l’éducation et à la formation est fondamental pour construire un avenir familial stable et épanoui.
Quelles sont les avancées que vous saluez le plus ?
Le 24 décembre 2024, il y a eu la présentation des propositions qui ont été soumises au Conseil supérieur des Oulémas par Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine et Président du Conseil, que Dieu L’assiste, ainsi que l’avis du Conseil supérieur des Oulémas sur ces propositions. Nous étions très heureux de constater que la majorité des propositions concernant les questions prioritaires qui ont été soulevées par les acteurs écoutés a reçu un avis favorable du Conseil supérieur des Oulémas. Et même les propositions qui n’ont pas été acceptées en l’état ont été concernées par d’autres propositions répondant aux problématiques réelles auxquelles sont confrontées les familles aujourd’hui et auxquelles il était temps d’apporter des réponses. Les 139 propositions formulées par l’Instance chargée de la révision de la Moudawana ainsi que l’avis du Conseil supérieur des Oulémas sont actuellement remis aux ministres concernés, et le processus suit son cours, y compris les étapes législatives et parlementaires.
Quel est votre regard sur l’évolution du droit des femmes au Maroc ?
Sous le Leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, les femmes marocaines ont réalisé des progrès significatifs en matière d’accès à leurs droits, particulièrement grâce à la Moudawana de 2004 et à la Constitution de 2011 qui consacre l’égalité entre hommes et femmes. Aujourd’hui, les femmes accèdent de plus en plus à l’éducation et aux études supérieures, avec des résultats très remarquables. Et c’est normal qu’elles revendiquent leurs droits au sein de la famille et de la société. Aussi plusieurs propositions importantes ont été avancées pour s’aligner avec les dispositions de la Constitution de 2011 en matière de renforcement de l’équilibre et la résilience de la famille ainsi que l’égalité homme-femme, comme la possibilité pour les époux de choisir le régime matrimonial qui leur convient, garantissant l’équilibre des droits en termes de gestion et bénéfice des biens familiaux.
Un autre point essentiel est l’introduction de la responsabilité juridique commune, qui permet aux femmes de gérer les affaires de leurs familles, y compris prendre des décisions concernant leurs enfants en concertation et de manière égale avec leur mari ou ex-mari. En outre, des mesures pourraient être prises, par les époux et selon leur volonté de leur vivant, pour équilibrer la répartition des biens de la famille entre leurs enfants, après un décès. Ainsi, les parents pourront décider, grâce à la proposition du Conseil supérieur des Oulémas, d’utiliser la «hiba» aux filles, qu’ils aient des garçons ou non et que les filles soient majeures ou mineures au moment du décès de l’un des parents. La «hiba» est aussi applicable pour une épouse non-musulmane. Ces avancées se font dans le respect de la Charia et viennent renforcer l’équilibre au sein de la famille entre l’homme et la femme.
Comment surmonter les résistances à la réforme de la Moudawana qui se font jour ?
Seules certaines des 139 propositions ont été annoncées, notamment celles couvertes par des textes coraniques ou par la sunna, et qui nécessitaient l’avis du Conseil supérieur des Oulemas. Des débats sont apparus dans l’espace public et sur les réseaux sociaux, véhiculant parfois des informations erronées ou non fondées. Il est donc très important de clarifier les propositions, comme cela a été signalé dans le Communiqué du Cabinet Royal du lundi 23 décembre 2024 qui a précisé que Sa Majesté le Roi que Dieu L’assiste, a demandé d’accompagner les citoyennes et citoyens en leur expliquant la réforme annoncée et les motivations de ces changements. Je le répète : la réforme ne cherche pas à accorder des droits aux femmes au détriment des hommes, mais à renforcer l’équilibre et la résilience des familles, et préserver l’intérêt général des enfants.
Comment garantir que cette réforme aura un impact durable sur les familles et leur bien-être ?
La première priorité est, comme je l’ai mentionné, d’assurer une communication claire et une appropriation de cette révision par les citoyennes et les citoyens. Il est également crucial, ce que souligne aussi le Communiqué du Cabinet Royal, de soutenir les familles par des programmes de sensibilisation, de formation et de médiation familiale, ainsi que par des politiques publiques ciblant la famille et impliquant tous les départements ministériels et les acteurs concernés. Offrir des services sociaux conçus pour les familles, à l’exemple de la généralisation des crèches ou des programmes d’incitations fiscales en soutien au mariage et à la parentalité sont également nécessaires pour renforcer la résilience et le bien-être des familles face aux défis économiques et sociaux actuels et futurs.